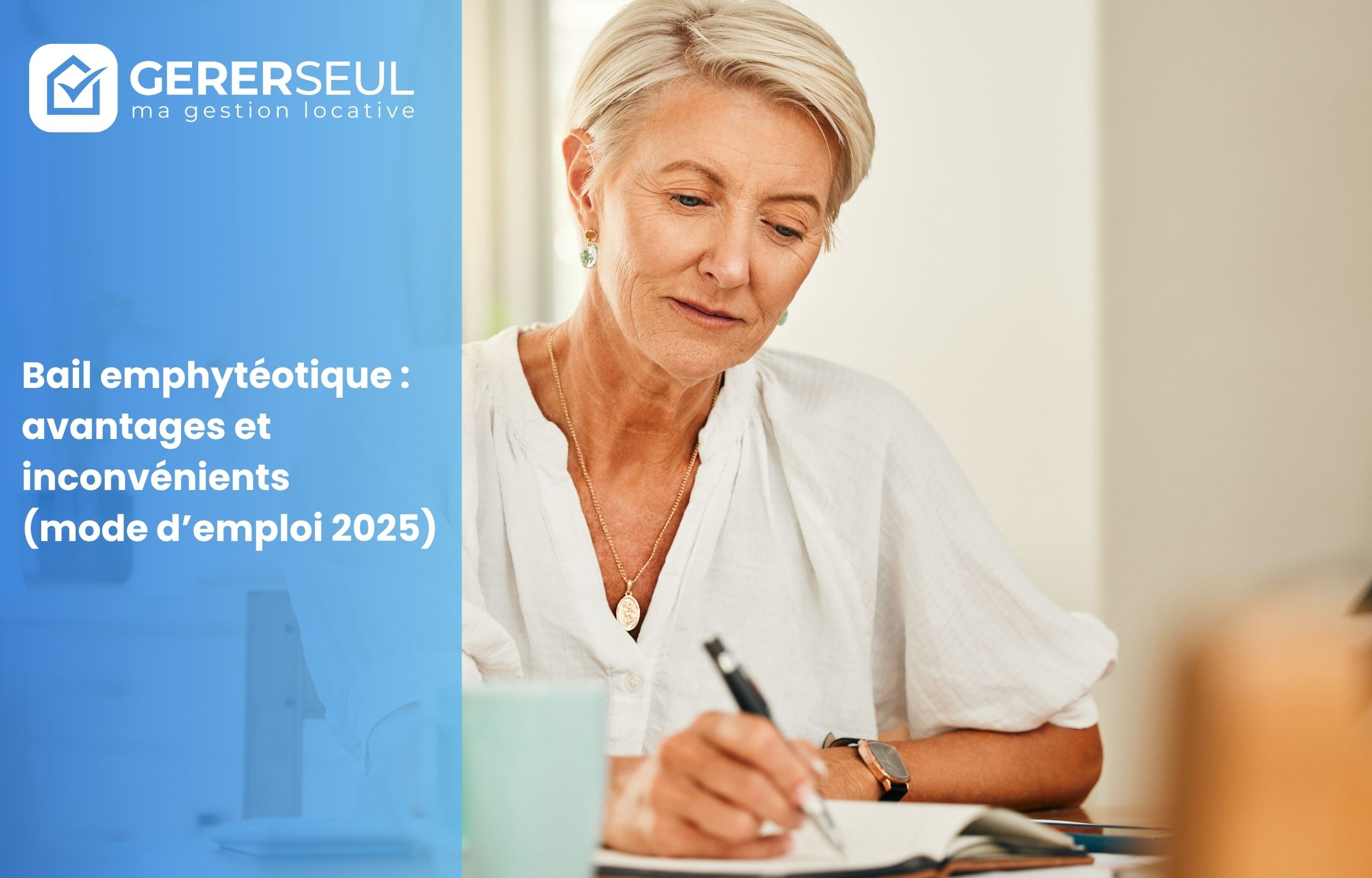
Le bail emphytéotique est un contrat de très longue durée – entre 18 et 99 ans – qui accorde au preneur (appelé emphytéote) un droit réel immobilier sur le bien loué. Il se situe à mi-chemin entre la location classique et la quasi-propriété.
Réglementé par les articles L.451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, il permet de valoriser un terrain ou un immeuble sans en céder la propriété.
Ce bail, souvent utilisé dans les montages d’investissement ou les opérations d’aménagement public, suppose de bien comprendre son cadre juridique, ses atouts et ses contraintes.
Définition et cadre juridique essentiel
Le bail emphytéotique est conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, sans tacite reconduction.
Il confère à l’emphytéote un droit réel – c’est-à-dire un droit qui s’attache à la chose elle-même, non à la personne. Ce droit est cessible, saisissable et hypothécaire. En pratique, cela permet au preneur de financer des constructions sur le terrain loué, en les donnant en garantie à une banque.
À lire : Bail vide ou bail meublé : comment choisir en 2026 ?
La contrepartie du droit accordé est le paiement d’une redevance annuelle, appelée canon emphytéotique, souvent symbolique (quelques centaines d’euros par hectare ou par bâtiment, selon les cas). Cette redevance peut être indexée sur l’indice du coût de la construction (ICC) ou sur un indice INSEE convenu au contrat.
Exemple : un terrain de 2 000 m² donné en bail emphytéotique à une association peut générer un canon de 500 € par an, revalorisé de 2 % chaque année.
Les obligations de l’emphytéote
Pendant toute la durée du bail, le preneur doit :
– conserver et améliorer le bien loué ;
– ne pas en diminuer la valeur ;
– assumer toutes les charges, y compris impôts et travaux d’entretien.
S’il cesse de payer la redevance pendant deux années consécutives, le bailleur peut demander la résolution judiciaire du contrat (article L.451-9 du Code rural).
Fiscalité : qui paie la taxe foncière ?
Conformément à l’article 1400 II du Code général des impôts, c’est l’emphytéote qui est redevable de la taxe foncière. Il est considéré comme le véritable “occupant propriétaire” pendant la durée du bail.
La jurisprudence récente (CE, 17 juillet 2024, n°470228) a précisé que l’assujettissement suppose la publication du bail au fichier immobilier avant le 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition. Sans publication, la taxe peut rester due par le bailleur.
Fin du bail et réversibilité
À l’expiration du contrat, toutes les constructions, plantations et améliorations reviennent gratuitement au propriétaire, sans indemnité pour le preneur, sauf clause contraire.
C’est la règle dite de la réversibilité. En pratique, un terrain nu peut donc être restitué avec un immeuble édifié par le preneur — un mécanisme souvent utilisé dans le portage foncier ou l’aménagement urbain.
Formalisme
Le bail emphytéotique doit être conclu devant notaire et publié au service de la publicité foncière. Cette publication est essentielle pour son opposabilité aux tiers et pour son traitement fiscal.
Les avantages pour le propriétaire bailleur
Valoriser un bien sans le vendre
Le principal atout pour le bailleur est de conserver la nue-propriété du terrain tout en permettant sa valorisation.
Il confie au preneur la charge de construire, d’entretenir ou de moderniser le bien, et récupère, au terme du bail, un patrimoine amélioré.
À lire : Moisissure en location : causes, responsabilités et prises en charge
Exemple : un terrain nu donné en bail emphytéotique pour 50 ans à un exploitant hôtelier peut, à échéance, revenir au propriétaire avec un bâtiment d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros, sans qu’il ait eu à investir.
Aucune charge courante
L’emphytéote supporte la taxe foncière, les réparations, l’entretien et les assurances.
Le bailleur se trouve ainsi débarrassé des coûts d’exploitation tout en percevant une redevance régulière.
Revenus stables et prévisibles
Le bailleur bénéficie d’une redevance annuelle, généralement modeste mais prévisible et sécurisée. En cas de non-paiement pendant deux ans, il peut saisir le juge pour résilier le bail et récupérer le bien, enrichi des éventuelles constructions.
Outil d’aménagement
Dans le secteur public, ce mécanisme a inspiré le bail emphytéotique administratif (BEA), utilisé par les collectivités pour permettre la réalisation d’équipements publics sans cession du foncier (crèches, cliniques, campus).
Les inconvénients pour le propriétaire bailleur
Immobilisation longue
Le bien est indisponible pendant toute la durée du bail : 18 à 99 ans. Le propriétaire ne peut ni vendre librement, ni occuper, ni exploiter le terrain avant le terme, sauf résiliation judiciaire ou clause de sortie anticipée.
Redevance faible
Le canon emphytéotique est souvent très inférieur à la valeur locative de marché, car il tient compte des charges transférées au preneur et de la durée du bail.
Un terrain valant 200 000 € pourrait ainsi ne rapporter que 1 000 € à 2 000 € par an de redevance. Il faut donc considérer ce bail comme un outil patrimonial de long terme, non comme une source de rendement immédiat.
Complexité juridique
Le contrat exige une rédaction rigoureuse : clauses de travaux, garanties, assurances, pénalités, servitudes. L’acte notarié et la publication entraînent des frais initiaux de 3 000 à 5 000 €, selon la valeur du bien.
Suivi administratif
En cas de non-respect des obligations (travaux non réalisés, dégradations, revente sans autorisation), le bailleur doit engager une procédure judiciaire longue pour résoudre le contrat.
Les avantages pour l’emphytéote (preneur)
Un droit quasi-propriétaire
L’emphytéote dispose d’un droit réel sur le bien : il peut le céder, le donner en garantie hypothécaire ou l’exploiter librement pendant la durée du bail.
Ce droit est reconnu par les banques, qui peuvent financer des travaux ou des constructions sur cette base.
Exemple : un investisseur signe un bail emphytéotique de 60 ans pour construire un immeuble de bureaux. Grâce à son droit réel, il obtient un prêt bancaire de 4 millions d’euros, gagé sur la valeur de l’immeuble et du bail.
Un foncier “léger”
L’emphytéote ne paie pas le foncier à l’achat. Il verse une redevance annuelle souvent symbolique, ce qui réduit son besoin initial de capital. Cela permet de développer des projets immobiliers ou agricoles sur des terrains stratégiques sans coût d’acquisition.
Liberté d’exploitation
Le preneur peut créer des servitudes (accès, réseaux, stationnement) pour la durée du bail, faciliter les financements et exploiter le bien comme un propriétaire.
Les inconvénients pour l’emphytéote
Des charges importantes
L’emphytéote assume la taxe foncière, l’entretien, les grosses réparations, et toutes les charges normalement dues par un propriétaire. Sur une propriété bâtie, cela peut représenter 2 % à 3 % de la valeur du bien par an en coûts récurrents.
Aucune indemnité de sortie
À la fin du bail, les constructions reviennent intégralement au bailleur, sans compensation. La valeur économique du droit emphytéotique décroît avec le temps : à mesure que le terme approche, la valeur de cession du bail diminue fortement.
Risque de résiliation
Deux années de non-paiement de la redevance ou une dégradation grave du bien peuvent entraîner la résolution judiciaire. Les banques exigent donc souvent des garanties de bonne exécution (assurance, plan de maintenance, garanties financières).
Liquidité limitée
La cession d’un droit emphytéotique reste rare. Sa valeur dépend du nombre d’années restantes et du marché local. À 20 ans de l’échéance, un droit initialement valorisé 100 % peut ne plus valoir que 25 à 30 % de sa valeur d’origine.
Focus : le bail emphytéotique administratif (BEA)
Le BEA est la déclinaison publique du bail emphytéotique, créée par l’article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales.
Il permet à une collectivité territoriale, un hôpital ou une université de confier la construction et la gestion d’un équipement à un opérateur privé, sans vendre le terrain.
Exemples :
- construction d’un centre hospitalier sur un terrain communal ;
- réalisation d’une résidence étudiante ou d’un parking public ;
- partenariat public-privé (PPP) avec une durée d’exploitation de 40 à 60 ans.
Le preneur supporte la taxe foncière et les charges, tandis que la collectivité récupère gratuitement l’équipement à la fin du bail.
Fiscalement, le BEA est assimilé à un bail emphytéotique ordinaire : l’assujettissement à la taxe foncière dépend également de sa publication.
Check-list : est-ce le bon outil ?
✔️ Projet d’exploitation longue (≥ 18 ans) avec horizon clair.
✔️ Objectif de construction ou de réhabilitation sans achat du terrain.
✔️ Capacité à assumer la taxe foncière et les entretiens lourds.
✔️ Clauses verrouillées : travaux, indexation, assurances, pénalités, résiliation.
✔️ Anticipation de la sortie de bail : restitution, réversibilité, ou clause de démolition.
Comparaisons rapides
- Bail à construction : proche du bail emphytéotique mais réservé à la construction de bâtiments neufs. Le preneur s’engage à édifier un immeuble et le bail est conclu pour 18 à 99 ans également.
- Bail réel solidaire (BRS) : destiné à l’accession sociale à la propriété. Le foncier reste la propriété d’un Organisme de Foncier Solidaire (OFS), le ménage achetant uniquement le bâti.
Sources :
- Légifrance – Code rural et de la pêche maritime, art. L.451-1 à L.451-14
- Code général des impôts, art. 1400 II
- Conseil d’État, décision du 17 juillet 2024, n°470228
- Code général des collectivités territoriales, art. L.1311-2
- Service-public.fr – Bail emphytéotique et bail à construction

