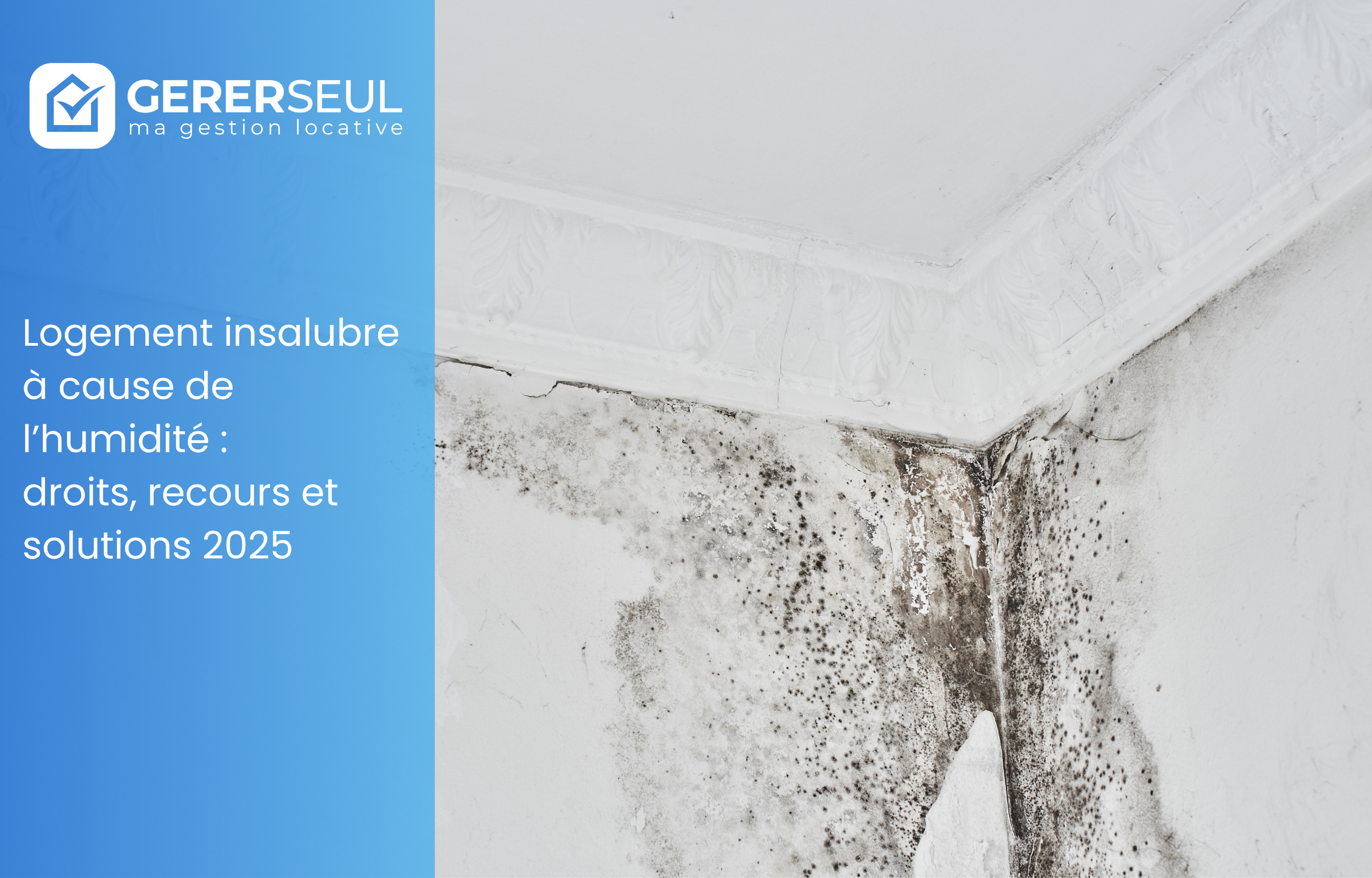
En 2024, les ARS (Agences Régionales de Santé) ont recensé environ 12 000 signalements liés à « l’humidité ou aux moisissures », révélant la persistance d’un problème sanitaire majeur dans l’habitat, qualifié à juste titre d’« habitat indigne » (source : DGCL).
Humidité et insalubrité : ce qu’il faut comprendre
Différence entre logement indécent, insalubre et dangereux
Un logement est indécent lorsqu’il ne respecte pas les critères de décence, notamment l’étanchéité aux infiltrations ou aux remontées d’eau (Décret n° 2002‑120). Il devient insalubre s’il représente un risque grave pour la santé, selon l’article L1331‑22 du Code de la Santé Publique. Le statut de logement dangereux se discerne par l’existence d’un péril imminent (risques électriques, structurels…) qui justifie une intervention immédiate.
Voici un tableau comparatif pour clarifier les distinctions — définitions, textes légaux, autorités compétentes et conséquences :
À lire : Qui peut bénéficier de la garantie Visale d’Action Logement en 2026 ?
| Catégorie | Définition / Texte applicable | Autorité compétente | Conséquences possibles |
|---|---|---|---|
| Logement indécent | Absence de protection contre infiltrations (Décret 2002‑120) | Mairie, services locaux | Travaux exigés au bailleur |
| Logement insalubre | Danger grave pour la santé (CSP art L1331‑22) | ARS, maire, préfecture | Travaux, relogement ou interdiction d’habiter |
| Logement dangereux | Risques immédiats (électriques, structurels…) | Mairie, préfecture | Évacuation, relogement, réparations urgentes |
Les principaux types d’humidité
Les causes de l’humidité sont variées : la condensation, souvent due à une ventilation insuffisante ou à des ponts thermiques, favorise l’apparition de moisissures logement. L’infiltration trouve son origine dans des défauts de toiture, des façades fissurées ou des joints défectueux. Les remontées capillaires, quant à elles, résultent du manque ou défaut de barrière étanche, laissant les murs poreux absorber l’humidité. Enfin, l’humidité accidentelle, due à un dégât des eaux non traité, peut rapidement détériorer les surfaces concernées. Ce panorama des causes mérite d’être illustré par un schéma radial explicatif.
Risques sanitaires prouvés
L’humidité s’invite dans l’air intérieur, favorisant les spores de moisissures, les acariens et d’autres allergènes. Selon l’OMS, un seuil de 500 cfu/m³ de spores est considéré comme dangereux pour la santé. L’exposition chronique augmente les risques de maladies respiratoires comme l’asthme, les infections ORL et les allergies. Une étude INSERM de 2023 révèle une hausse de 30 % du risque de toux chronique chez les enfants exposés. Il est recommandé de maintenir un taux d’humidité relative entre 45 % et 60 % pour limiter ces effets néfastes.
Obligations du bailleur face à l’humidité insalubre
Obligation de délivrance d’un logement décent – article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Le bailleur est tenu de mettre à disposition et maintenir un logement décent durant toute la durée du bail. Depuis 2025, cette exigence inclut une performance énergétique minimale (DPE supérieure à G), impliquant une lutte contre l’humidité pour garantir efficacité thermique et salubrité.
Décret de décence : exigences spécifiques contre l’humidité
L’article 2 du décret de décence impose que le logement soit clos, couvert et étanche, même en ce qui concerne toiture et murs. Par ailleurs, le décret 2017‑312 renforce les critères en intégrant les infiltrations d’air parasites dans l’évaluation de la conformité du logement.
À lire : Bail vide ou bail meublé : comment choisir en 2026 ?
Responsabilité civile et pénale du bailleur
Le bailleur a une obligation de résultat en termes de protection de la santé du locataire. En cas de manquement, le locataire peut réclamer dommages‑intérêts ou astreinte si les travaux sont retardés. Bien que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2024 (Civ. 3ème) ne traite pas directement de l’humidité, il rappelle qu’un bailleur doit garantir un logement décent tout au long du bail, quels que soient l’état initial ou l’origine de l’humidité (ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Village de la Justice).
Comment faire reconnaître l’insalubrité liée à l’humidité ?
Reconnaître l’insalubrité due à l’humidité :
- Constater l’humidité : réaliser des photos datées, mesurer le taux d’humidité ( > 70 %) à l’aide d’un hygromètre, joindre un certificat médical si des symptômes sont présents.
- Notifier le bailleur : envoyer une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, exposer les faits et demander la réalisation urgente des travaux dans un délai (par exemple, 15 jours).
- Saisir la CAF : en cas de logement non-décent, la CAF peut suspendre l’APL sur la base de l’article L822‑9 du CCH.
- Contacter l’ARS ou la mairie : déposer un signalement justificatif auprès du service hygiène ou logement.
- Inspection administrative : un inspecteur évalue, classe le logement (A, B ou C — C signifiant insalubrité grave) et transmet le dossier à la préfecture.
- Arrêté préfectoral : si la condition C est retenue, un arrêté peut imposer des travaux, un relogement ou interdire l’occupation.
- Suivi : veiller à ce que les prescriptions soient effectives jusqu’à la levée de l’arrêté.
Recours du locataire si le bailleur ne réagit pas
Exception d’inexécution et réduction de loyer
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, il est possible d’invoquer l’exception d’inexécution devant le Juge des Contentieux de la Protection. Cependant, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 novembre 2024, on ne peut interrompre le paiement des loyers que si le logement est véritablement inhabitable. Ce jugement précisait qu’un logement non décent (humidité, moisissures) mais toujours habitable ne justifie pas cette exception (Village de la Justice).
Résiliation judiciaire ou départ anticipé
Si l’habitat reste dégradé plus de deux mois après la mise en demeure, le locataire peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement d’une clause résolutoire. Dès lors qu’un certificat ARS démontre une menace pour la santé, le préavis est réduit à un mois conformément à l’article 15‑I de la loi de 1989.
Dommages-intérêts pour troubles de jouissance
Le locataire peut réclamer une indemnisation couvrant frais d’hébergement provisoire, dommages au mobilier, frais de santé, etc. Inclure un exemple chiffré dans un encadré permet de faciliter la compréhension et la préparation des dossiers juridiques.
Qui finance les travaux contre l’humidité ?
Aides publiques 2025
Le programme MaPrime Logement Décent (MPLD) prend désormais en charge 50 % des travaux anti-humidité, avec un plafond fixé à 25 000 €. Il peut être complété par des dispositifs comme l’Éco‑prêt copropriété ou les aides Actions Logement (subvention ou avance remboursable), sous conditions de ressources et possibilité de cumul.
Assurance propriétaire non-occupant (PNO)
Vérifier si la garantie dégâts des eaux couvre les sinistres liés à l’humidité : attention, la condensation chronique est souvent exclue. En cas de sinistre, la déclaration doit se faire dans les 5 jours pour préserver les droits à indemnisation.
Travaux éligibles et coûts moyens
Les principaux travaux et leurs coûts estimés sont les suivants : drainage périphérique (8 000 à 12 000 €), cuvelage de cave (environ 150 €/m²), VMC double flux (≈ 5 000 €). Il est crucial d’accompagner les demandes de subventions avec devis détaillés.
Prévenir le retour de l’humidité
Ventilation et aération quotidiennes
Il est recommandé d’aérer chaque pièce au moins 10 minutes, matin et soir, de veiller au bon fonctionnement de la VMC et de nettoyer les grilles d’entrée d’air deux fois par an. Ces gestes simples, rappelés par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, sont essentiels pour éviter la prolifération des moisissures (Village de la Justice).
Entretien du bâti par le bailleur
Le bailleur doit assurer une maintenance régulière : réviser la toiture, les chéneaux et les joints des fenêtres. Les joints de faïence dans les pièces humides doivent être retraités tous les cinq ans pour éviter les infiltrations.
Bonnes pratiques du locataire
Le locataire doit veiller à ne pas obstruer les aérations, privilégier le séchage du linge à l’extérieur, maintenir une température de 19 °C et peut compléter par des absorbeurs d’humidité si nécessaire (ARS Auvergne-Rhône-Alpes).
FAQ
À quel taux d’humidité un logement devient-il insalubre ?
Un taux dépassant 65–70 % d’humidité relative peut conduire à une qualification d’insalubrité (normes ARS).
Puis-je suspendre mon loyer si le bailleur ne réagit pas ?
Non, sauf décision judiciaire ; en revanche, l’APL peut être suspendue si le logement est jugé non-décent.
Qui paye l’expertise humidité ?
Le bailleur est en principe responsable ; si le juge l’ordonne, le coût peut lui être imputé.
Quelles démarches pour faire intervenir l’ARS ?
Il faut envoyer un signalement accompagné de preuves (photos, mesures), déclencher une visite, obtenir un rapport et, le cas échéant, en obtenir un arrêté préfectoral.
Le bail peut-il être résilié sans préavis ?
Oui, si la situation met gravement la santé en danger, sur décision judiciaire ou grâce à une clause résolutoire, avec réduction du préavis à un mois.
Sources
- ARS Auvergne-Rhône-Alpes : conseils pratiques pour prévenir les moisissures (ARS Auvergne-Rhône-Alpes)
- ARS Auvergne-Rhône-Alpes (5 août 2025) : démarches en cas d’habitat indigne ou insalubre (ARS Auvergne-Rhône-Alpes)

