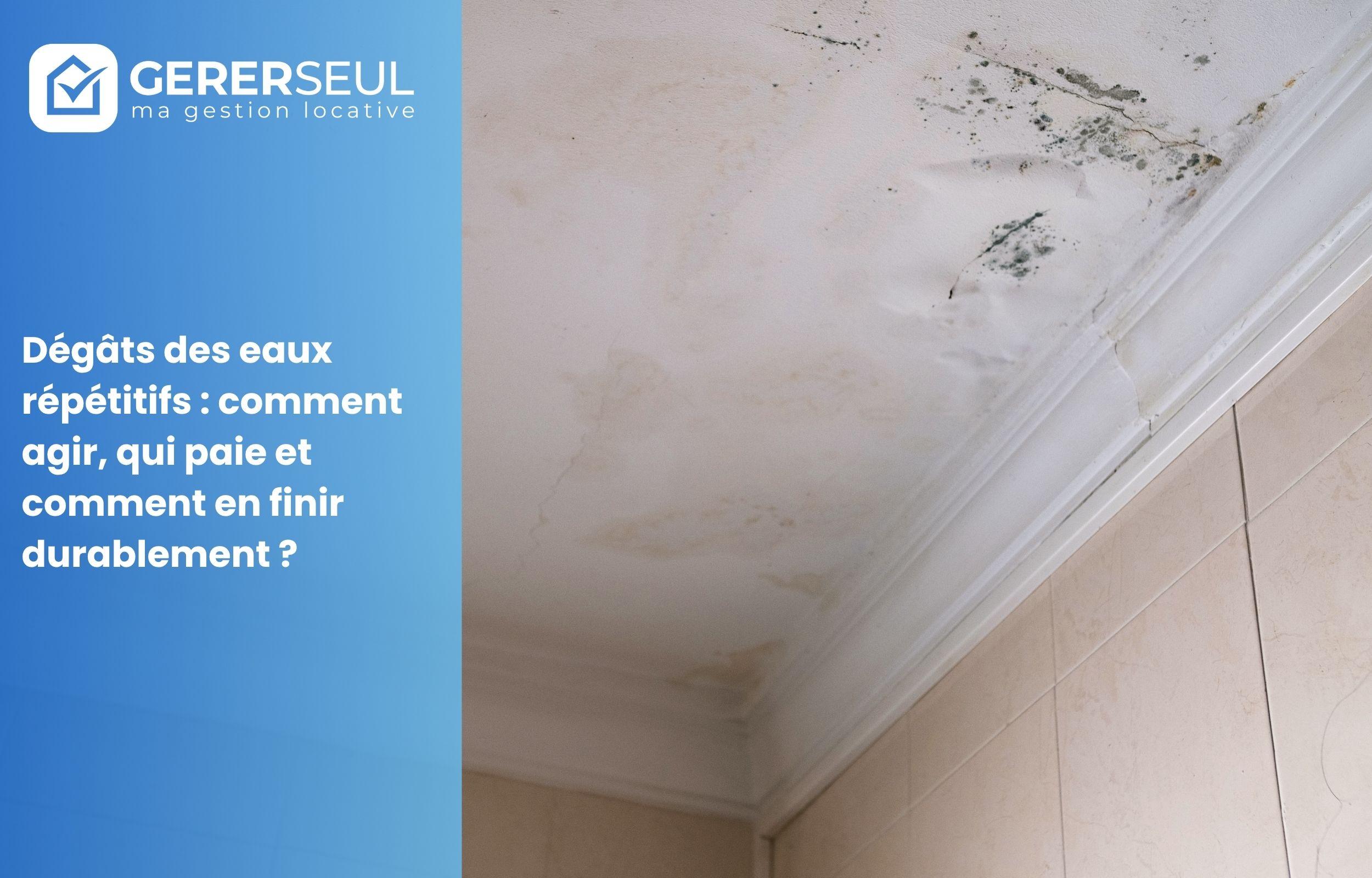
Une fuite d’eau est toujours une source de stress pour un locataire comme pour un propriétaire. Mais lorsque le problème se répète à intervalles réguliers, la situation devient rapidement insupportable : infiltrations récurrentes, peinture abîmée malgré des réparations récentes, mobilier endommagé à plusieurs reprises… On ne parle plus alors d’un simple accident domestique, mais d’un défaut structurel du logement ou de l’immeuble.
À travers cet article, nous proposons un guide complet pour comprendre les causes possibles, identifier les responsabilités, engager les bonnes démarches auprès des assurances et, surtout, mettre fin à la répétition des sinistres. Car s’il est normal d’avoir à gérer une fuite isolée, il ne l’est pas de subir un dégât des eaux plusieurs fois dans l’année.
Comprendre la récurrence : les causes les plus fréquentes
Un dégât des eaux ponctuel peut avoir de multiples origines. Mais lorsqu’il se répète, c’est souvent le signe que la cause n’a pas été correctement identifiée ou que les réparations effectuées n’ont pas réglé le problème de fond.
Les réseaux de canalisations constituent la première source de suspicion. Les colonnes verticales, qui assurent l’évacuation des eaux usées dans les immeubles, peuvent présenter des microfissures ou des joints usés qui entraînent des suintements réguliers. Dans les parties privatives, les siphons de douche ou de cuisine mal entretenus, les coudes de tuyauterie trop sollicités ou les flexibles vieillissants provoquent aussi des fuites récurrentes.
Les défauts d’étanchéité dans les pièces d’eau sont une autre cause classique. Un bac à douche fissuré, des joints de silicone moisis ou un receveur mal posé laissent s’infiltrer l’eau au fil du temps, entraînant les mêmes taches d’humidité sur les plafonds ou les murs voisins.
Il faut aussi envisager des causes extérieures au logement : infiltrations par la toiture, fissures de façade, balcons dont l’évacuation des eaux est mal conçue. Les cycles météorologiques révèlent souvent ces défauts, puisqu’on constate l’apparition de taches à chaque épisode de pluie.
Enfin, certains cas tiennent davantage à l’usage ou au manque d’entretien. Une machine à laver dont le tuyau est fissuré, une VMC hors service qui provoque de la condensation, ou encore un balcon arrosé sans évacuation peuvent expliquer des dégâts qui semblent se répéter sans raison technique majeure.
À lire : Visite du logement pendant préavis : quels sont les droits de chacun ?
Identifier les responsabilités : qui doit agir ?
Face à un dégât des eaux récurrent, la question essentielle reste de savoir qui doit prendre en charge les réparations. Le locataire a l’obligation d’alerter immédiatement le propriétaire ou le syndic dès qu’un incident survient. Il doit aussi protéger ses biens, couper l’eau si possible et faciliter l’accès pour rechercher la fuite.
Le bailleur, de son côté, doit coordonner les investigations et faire intervenir un professionnel pour réparer les éléments privatifs (canalisations, salle de bain, cuisine). Si l’origine est suspectée dans les parties communes, il doit prévenir le syndic. Celui-ci devient alors le chef d’orchestre des réparations structurelles : reprise d’une colonne d’évacuation, vérification de l’étanchéité des balcons ou des toitures.
Les assureurs jouent un rôle clé dans ce processus. Le locataire bénéficie généralement d’une assurance multirisques habitation, tandis que le bailleur est couvert par une assurance propriétaire non occupant (PNO). L’immeuble, enfin, dispose d’une assurance multirisque gérée par le syndic. Ces différentes couvertures se coordonnent pour indemniser les dommages matériels, mais la réparation de la cause incombe toujours au responsable identifié.
La procédure à suivre étape par étape
Dès la constatation d’un dégât des eaux, la priorité est de sécuriser les lieux. Couper l’eau, protéger le mobilier et prendre des photographies horodatées sont des réflexes essentiels. Il faut ensuite déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés à son assureur, tout en prévenant le bailleur, le syndic et le voisin suspecté si l’origine est extérieure au logement.
À lire : Pourquoi l’isolation est un enjeu central dans un logement locatif ?
Vient ensuite la recherche de la fuite. Il est préférable de missionner un plombier spécialisé qui utilise des techniques non destructives : mesure d’humidité, caméra endoscopique, gaz traceur. Le rapport fourni est précieux pour déterminer la cause et engager les réparations nécessaires.
Une fois la fuite identifiée et réparée, il convient de remettre en état les dommages, qu’il s’agisse de peinture, de revêtements de sol ou de mobilier endommagé. Un suivi dans les semaines qui suivent est fortement conseillé, car une reprise des taches ou une nouvelle infiltration signale souvent une réparation incomplète.
Si malgré tout les dégâts se répètent, il devient nécessaire d’escalader la procédure.
Escalader en cas de récidive
Lorsqu’un bailleur ou un locataire constate que les dégâts se reproduisent, il doit officialiser sa démarche. Une première étape consiste à adresser un courrier recommandé au responsable présumé – syndic, voisin ou bailleur – en rappelant l’historique des sinistres et en joignant toutes les preuves.
Si aucune action n’est entreprise, la mise en demeure avec un délai ferme constitue l’étape suivante. Elle annonce clairement qu’une expertise contradictoire sera demandée en cas d’inaction.
L’expertise amiable contradictoire permet de réunir toutes les parties (assureurs, bailleur, syndic, locataire) et de mettre à plat la situation. Si elle échoue ou si les conclusions ne sont pas suivies d’effet, il est alors possible de saisir le juge des contentieux de la protection en référé. Celui-ci peut désigner un expert judiciaire, imposer la réalisation des travaux et accorder une indemnisation pour le trouble de jouissance.
Qui paie quoi ? Répartition des frais et indemnisation
La répartition des frais dépend de l’origine du sinistre. Si la cause est imputable à un équipement du locataire, celui-ci doit prendre en charge la réparation, tandis que son assurance couvre les dommages à son mobilier. Lorsque la fuite provient d’une installation privative appartenant au bailleur, ce dernier doit intervenir et son assurance PNO prend en charge les dégâts causés au logement.
Lorsque la cause se situe dans les parties communes – toiture, colonne, façade – le syndic pilote les réparations et c’est l’assurance de l’immeuble qui indemnise les dommages. Il arrive cependant que les assureurs réduisent ou retardent leur prise en charge si le problème n’est pas réparé durablement. D’où l’importance de conserver toutes les factures et attestations prouvant que des travaux correctifs ont bien été réalisés.
Les droits du locataire en cas de répétition
Un locataire est en droit d’exiger la jouissance paisible du logement. Si les infiltrations se répètent et que le bailleur tarde à agir, il peut demander une réduction de loyer, voire une indemnisation pour le préjudice subi. La rétention unilatérale du loyer reste risquée, car elle peut être considérée comme un manquement contractuel, mais une action devant le juge est tout à fait possible.
Dans les cas les plus graves, lorsque le logement devient temporairement inhabitable, un relogement peut être envisagé, soit par accord amiable avec le bailleur, soit via l’assurance.
Garantir la durabilité des réparations
Mettre fin définitivement aux dégâts des eaux récurrents implique de privilégier des solutions pérennes. Il ne s’agit pas de refaire un joint rapidement, mais de vérifier l’étanchéité complète de la douche, de remplacer un pan de mur si nécessaire, ou encore de reprendre l’intégralité d’une colonne défectueuse.
Les bailleurs comme les locataires doivent conserver les rapports de recherche de fuite, les factures détaillées, les photos avant et après travaux ainsi que toute attestation d’étanchéité. Ces pièces constituent autant de preuves en cas de récidive et facilitent les recours auprès des assurances.
Prévenir les dégâts des eaux à répétition
La prévention reste le meilleur moyen d’éviter les désagréments. Les bailleurs peuvent prévoir un entretien annuel des joints de silicone, des siphons et des robinets d’arrêt. Les flexibles de machines à laver doivent être changés régulièrement, de préférence tous les cinq ans. Les copropriétés, de leur côté, ont intérêt à programmer des contrôles périodiques des colonnes d’évacuation, de la toiture ou de la ventilation.
Des dispositifs simples comme des détecteurs d’eau placés sous les éviers ou près du ballon d’eau chaude permettent également d’agir rapidement en cas de fuite naissante. Enfin, une information claire des locataires sur les gestes de prévention (aération régulière, entretien des siphons, vigilance sur l’usage des balcons) contribue à réduire les risques.
Un dégât des eaux isolé peut être traité relativement simplement, mais sa répétition révèle presque toujours un problème structurel ou un défaut d’entretien. Pour en sortir, il est indispensable d’identifier précisément la cause, de déterminer les responsabilités et de documenter chaque étape du processus.
En cas de récidive, l’escalade amiable puis judiciaire reste la voie la plus efficace pour obtenir une réparation durable et une indemnisation du préjudice subi. Les bailleurs ont tout intérêt à agir avec rigueur et méthode, car un logement victime de fuites répétées perd rapidement de sa valeur locative et peut générer un contentieux lourd avec les locataires.
Grâce à une bonne coordination entre occupants, propriétaires, syndics et assureurs, il est toutefois possible d’éradiquer durablement ce type de sinistre et de redonner au logement toute sa sécurité et son confort.
Sources
- Service-public.fr – Assurance habitation et dégâts des eaux
- Fédération française de l’assurance – Constat amiable dégât des eaux
- ANIL – Droits du locataire face aux troubles de jouissance

